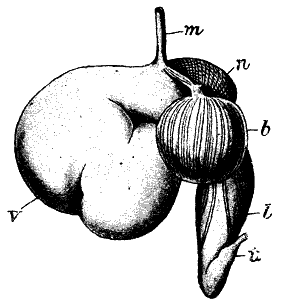Mon corps était hier au centre commercial. Pour acheter des chaussettes et des caleçons (de type boxer). Ces achats peuvent surprendre de la part d’un corps qui n’a plus vraiment toute sa tête.
Mais tu n’es pas dupe, n’est-ce pas, tu sais parfaitement ce que cela signifie.
Alors pourquoi ne pas rester avec des chaussettes trouées et des boxers râpés ? Simple considération esthétique, peut-être, ou éthique (ce qui revient au même)… Je n’ai aucune intention de mépriser mon corps et de le traiter par dessus la jambe, sous prétexte que son cerveau l’a déserté. Si mon cerveau s’est fendu d’une parka fourrée orange à bord du Tsibalt, mon corps peut bien s’acheter une poignée de paires de chaussettes et de caleçons taille L.
Je le redirai bientôt, mon corps n’a pas beaucoup d’idées. Mon corps se garde donc d’avoir un avis sur tout. Concernant les chaussettes et les caleçons, mon corps se limite aux choses ternes et classiques, banales, ce que tu appellerais les basics.
Dès l’entrée du magasin, mon corps fut frappé par la tenue atroce d’une vendeuse.
La pauvre étant probablement obligée, par contrat, d’être un miroir de la mode féminine du moment, mon corps a d’abord cru que ce n’était pas le choix de la vendeuse de porter des pantalons informes, courts et serrés aux mollets, à l’entre-jambes lâche, aux cuisses ballotantes. Son « haut » (une chemise ?) était un virulent manifeste contre l’idée de forme, quelle qu’elle soit, puisqu’il tenait plus du sac troué aux bras et à la tête. Le tout était « coupé » dans des tissus imprimés que mon corps n’aurait pas souhaités aux fenêtres de mon pire ennemi.
Mon corps a ensuite vu une autre vendeuse vêtue d’un combi-short. Un combi-short. Est-ce bien le terme ? C’était un bleu de travail passé à l’eau Daquin, porté sur un collant, coupé et échancré au niveau de l’aine, avec des manches chauve-souris.
Elles n’avaient pas l’air malheureux, ces petites vendeuses, ce qui a fait dire à mon corps qu’à quarante ans, étant devenu un vieux con, il ne comprenait plus rien au monde que mon cerveau regardait, avec bonheur, disparaître derrière la ligne de l’horizon antarctique.
Ce n’était certes pas la première fois que mon corps remarquait que les femmes s’habillaient de façon étrange (n’y vois aucune attaque, tu as toujours été d’une parfaite élégance). Mais là, dans ce magasin, ce fut une révélation : il me confirma que mon cerveau avait eu raison de quitter un monde où les créateurs de mode étaient de jeunes psychopathes au nez poudré de cocaïne, des types défoncés au champagne à l’arrière d’un Hummer de milliardaire russe roulant comme un dingue dans les rues boueuses d’une ancienne république soviétique, des escrocs surpayés flashant sur des femmes fagotés de fringues bariolées récupérées dans les poubelles des années quatre-vingt.
Mon corps se pressait donc de rentrer à la maison, muni de ses achats, quand il arriva peu avant l’angle des rues Couture et d’Elbeuf.
Le gars, que je n’avais pas vu venir, s’est écrié avec rage : « J’ai une sale gueule mais j’ai un putain de beau corps ! ». Le gars tenait son tee-shirt au-dessus du nombril et exhibait un ventre bronzé, soigneusement bodybuildé, l’ensemble pouvant être comparé, sans exagération, à une « tablette de chocolat ».
Son visage n’était pas hideux, ses cheveux longs étaient tirés en arrière par une sorte de serre-tête à la façon de certains footballeurs, mais quoiqu’il en soit, mon corps n’avait pas encore réalisé que le gars s’adressait à moi.
Il est vrai que mon corps ne pouvait tenir la comparaison avec le sien. Mon corps pèse quatre-vingts kilos pour un mètre quatre-vingts (je n’ai jamais fait de sport), et, sans être gros, mon corps a du bide, tu le sais bien. À ce stade, il n’y avait donc rien à redire, et, si le gars lui en avait laissé la possibilité, mon corps aurait convenu qu’il disait vrai pour ce qui était de la comparaison du sien et du mien, mais qu’il se trompait certainement pour le visage.
Les choses sont allées très vite, et, je te le rappelle, mon cerveau était loin de cette rue Couture que mon corps s’apprêtait d’ailleurs à laisser pour remonter la rue d’Elbeuf jusqu’à la maison.
Le temps qu’il réalise que le gars s’adressait à moi, le gars m’avait dépassé. Ce qui ne l’empêchait pas de hurler : « T’as un faux corps, t’as une fausse tête, je t’emmerde ! ».